[ Cet article est disponible au format audio ici : https://tube.kher.nl/w/qNVVT5TxeT97frtQpns99W ]
Salut tout le monde,
Ça fait pas mal de temps que je n’avais pas fait d’article, mais là j’avais une envie pressante de vous parler d’un film que j’ai regardé hier soir et que j’ai trouvé particulièrement chouette. Et vous vous doutez sûrement que si je vous en parle, c’est parce que ça cause de véganisme…
Ce film, c’est « Le combat d’Alice », un film français de Thierry Binisti qui a été diffusé sur France 2 le 25 mars dernier et qui est disponible gratuitement en replay sur France TV jusqu’au 29 septembre 2025 (par ici : https://www.france.tv/series-et-fictions/films-tv/7061642-le-combat-d-alice.html).
Ce film, c’est l’histoire d’Alice, une ado de 15 ans particulièrement affectée par le décès de sa mère 2 ans auparavant et par le comportement de son père, qui gère le deuil en se plongeant corps et âme dans son boulot. Alice se retrouve exclue du lycée et en vacances prolongées à la campagne, chez ses grands parents. C’est là qu’elle se prend d’affection pour Viedoc, un jeune veau dans un champ voisin qu’elle visite chaque jour. Et c’est aussi là qu’elle rencontre Lola, une lycéenne un peu rebelle, mais surtout végane. Alice découvre alors des vidéos du style de celles de L214 et c’est la bascule : elle refuse désormais de manger de la viande et dévore tous les contenus qu’elle peut sur l’exploitation animale et le militantisme antispéciste. Et lorsqu’elle apprend que Viedoc doit être envoyé à l’abattoir, elle décide de tout faire pour le sauver.
Alors attention, dans la suite de cet article je vais pas mal spoiler. Alors si vous voulez découvrir le film avant, mettez de côté cet article pour plus tard.
Le premier truc que j’ai envie de partager au sujet de ce film, c’est que le personnage de Camille incarne à merveille toutes les émotions complexes d’une personne qui fait le lien entre la viande et l’animal et qui découvre l’horreur de l’exploitation animale. La jeune actrice joue très bien l’indignation, la colère, la tristesse, le désespoir, la rage et toutes les autres émotions que traverse son personnage.
Une autre chose que j’ai apprécié, c’est que le véganisme n’est pas présenté comme un truc de bobo urbain : ça change, ça fait plaisir. Là on est à la campagne, au milieu des vaches et du quotidien des éleveurs, bien loin de la ville.
Il y a d’ailleurs un passage étonnant où la grand-mère d’Alice invite Lola à déjeuner, et quand celle-ci lui répond qu’elle est végane, elle sait visiblement ce que ça implique car elle lui précise qu’elle a du gratin de légumes sans fromage pour elle. J’ai trouvé ce passage surprenant car cela laisse entendre qu’au fin fond de la campagne française, on sait ce qu’est le véganisme, et que ça ne pose de souci à personne. Dans la réalité on est encore malheureusement bien loin de cela…
Bon, et puis je dois préciser que j’ai particulièrement apprécié le personnage de Lola, qui, en plus d’être végane et engagée pour la cause écologiste, est aussi une personne queer, ce qui la rend particulièrement attachante à mes yeux.
J’ai trouvé notamment intéressant qu’elle soit devenue aussi engagée car ses parents le sont, mais qu’elle essaie de convaincre sa mère de devenir végane. C’est appréciable de voir que l’influence au sein de cette famille, ça marche dans les deux sens, que les adultes ne sont pas les seuls à exercer leur influence au sein du foyer.
Par contre, une chose qui m’a dérangé.e, c’est que la transition vers le véganisme est présentée comme un truc de jeune rebelle issue d’une famille de militants ou de jeune fille en crise. On trouve d’ailleurs trace de ce cliché âgiste jusque dans le synopsis, où il est dit d’Alice que (je cite) « elle s’engage avec toute la force et l’excès de son âge ». A ce sujet, je ne peux pas m’empêcher de remarquer que la mère de Lola, qui est végétarienne, présente sa fille végane comme plus radicale, avec tout ce qu’il y a de connotation négative dans le choix de ce terme : en gros, il y aurait d’un côté l’adulte mature végétarienne, et de l’autre côté la jeune rebelle un peu excessive qui est végane.
Ce n’est sûrement pas sans lien avec la réaction finale d’Alice, qui semble plus modérée dans son combat une fois que le climat familial s’est apaisé. Elle en arrive à se réjouir que son père ait réussi à lever les fonds nécessaires pour sauver un abattoir et veuille sortir avec une éleveuse… C’est ce qui m’a le plus surpris et dérangé dans ce film. Alors qu’au fur et à mesure du film on sent le père de plus en plus sensible aux discours de sa fille et qu’il ne parvient pas à trouver quoi que ce soit à lui opposer, il choisit au final de sauver un abattoir présenté comme garant du bien-être animal. Là où le film semblait promettre un final antispéciste, on se retrouve avec un final welfariste décevant… mais qui semble étonnamment satisfaire le personnage principal. Ce qui alimente l’idée que le véganisme est une phase que peuvent traverser des ados en crise, mais que ça leur passera un jour…
Mais à côté de ça, il y a plein d’autres aspects du film que j’ai trouvé sympathiques.
Par exemple, j’ai trouvé très intéressant de mettre en avant le fait qu’il ne suffit pas de faire le lien entre la viande et l’animal pour cesser d’en consommer. C’est parfaitement bien illustré par le passage où le jeune enfant d’une éleveuse, en mangeant son steak avec appétit demande à sa mère « c’est qui qu’on mange ? ». Cette question jette un froid car tout le monde redoute la réaction d’Alice, mais on sent bien que dans le quotidien de cette éleveuse et de ses enfants, il est tout à fait normal de consommer la chair des animaux qu’iels ont vu grandir dans leur élevage, et de se demander qui on mange à table.
Un autre point que j’ai trouvé intéressant, c’est que le militantisme antispéciste est présenté comme s’attaquant aux biens et non pas aux personnes. En l’occurrence, lors de l’opération visant à libérer Viedoc, on voit bien que la chute de Damien, le gardien du centre d’allotement, est accidentelle et que ça pose un sérieux cas de conscience aux militant.es présent.es. Cet aspect du film est intéressant en ce qu’il amène des questionnements sur la violence des actions militantes et sur ce que l’on peut qualifier (ou pas) de violent. Car vandaliser des locaux, ce n’est pas de la violence, ce qui l’est c’est de s’en prendre aux personnes.
[ Edit : Ma formulation au sujet de la violence prête à confusion. Ce que j’aurais dû dire, c’est que dans mon système moral, la violence exercée sur des biens/bâtiments/locaux pour faire cesser des souffrances inutiles (en l’occurrence l’exploitation et la mise à morts d’individus sentients) n’est pas moralement répréhensible. ]
Bon, et puis, je suis obligé.e de souligner un dernier point juste pour pinailler, mais présenter les personnes végé comme ne mangeant que des légumes, c’est plus possible en 2025 hein ! Pour le coup, ça peut se comprendre dans le contexte du film car Alice cesse de manger de la viande du jour au lendemain et n’a visiblement pas eu le temps de s’inquiéter de son équilibre nutritionnel. Mais bon, ça pique quand même de la voir manger uniquement des légumes à tous les repas la pauvre…
Allez, tout ceci étant dit, je le répète, mais j’ai trouvé ce film très chouette. Il aborde des thématiques importantes tout en nuance : que ce soit le véganisme, le quotidien difficile des éleveurs, le deuil ou bien encore l’adolescence. Je vous encourage à aller le regarder si ce n’est pas encore fait !
D’ailleurs, je précise pour conclure que ce film est inspiré du roman « 8865 » de Dominique Legrand, et que ça m’a donné envie de lire le livre ! Je vous en parlerai si je le lis, promis. Sur ce, prenez soin de vous, et doutez raisonnablement…
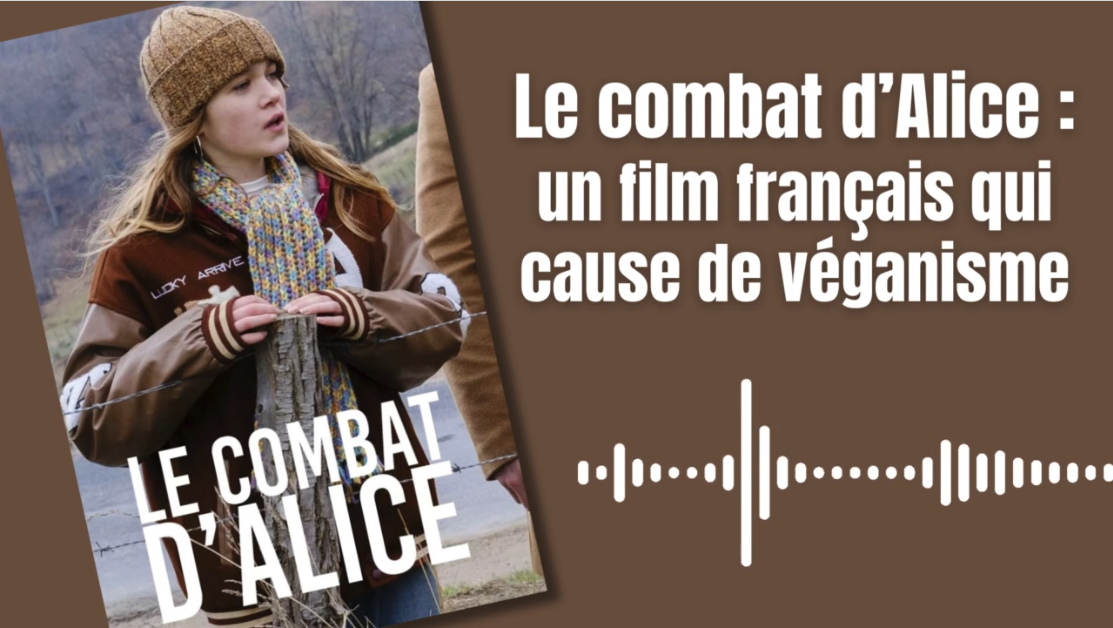
@Sohan
Bonjour, Sohan.
Je n’ai lu qu’en diagonale à cause du spoiler, et j’ai donc une question : est-ce que ça ne fait pas trop téléfilm ? Parce que rien que le titre « Le combat d’Alice » fait craindre le pire à ce niveau. Et les téléfilms, même sur un sujet intéressant, sont rarement bons, à tel point que je ne les regarde pas jusqu’au bout.
Je note cependant que les notes sur Allociné sont honorables, y compris de la part de la presse (ce qui laisse supposer que, du côté du public, ce ne sont pas que des véganes qui ont voté).
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=325726.html
Merci d’avance et belle journée ! 🌞